Etape 37 - Musée du Louvre - Splendeurs italiennes
Mercredi 28 décembre 2016. Dernière étape de ma visite des collections européennes. La Vierge à l'Enfant avec sainte Catherine et un berger, dite La Vierge au lapin (1576), du Titien. Au centre, la femme en robe rouge et manteau bleu est facilement identifiable : c’est la Vierge ; elle caresse un lapin tout en portant son regard sur son fils, Jésus Christ, que lui tend une femme vêtue et coiffée à la mode de l’époque. A droite, en arrière plan, un homme garde des moutons. Titien a peint ici une scène religieuse comme s’il s’agissait d’une scène de la vie quotidienne, empreinte de naturalisme et d’intimité.

|
La Vierge à l'Enfant avec le petit saint Jean-Baptiste, dite
La Belle Jardinière (1508), de Raphaël. Ni l'identité du commanditaire, ni les circonstances dans lesquelles La Belle Jardinière entra dans la collection royale ne sont connues. Après la Vierge du Belvédère (Vienne) et la Vierge au chardonneret(Florence), de 1505 - 1506, La Belle Jardinière, datée de 1507 ou de 1508, clôt, à la fin du séjour florentin de Raphaël, ses recherches sur le motif de la Vierge à l'Enfant avec saint Jean inscrit dans une composition dynamique et pyramidale au premier plan d'un paysage. |
La Vierge à l'Enfant avec le petit saint Jean, dite La Vierge au voile ou La Vierge au diadème bleu (1512), de Il Fattore. Aucun dessin connu de Raphaël n’est strictement préparatoire à cette composition, dont l’invention lui revient pourtant certainement, et pourrait se situer à Rome vers 1512. Proche de la Madone de Lorette (Chantilly, musée Condé), elle développe le même motif du sommeil – préfiguration de la Passion à laquelle la croix de saint Jean fait aussi allusion – et le même geste de la Vierge levant le voile. La palette claire et acidulée et la matière porcelainée de l’œuvre ont toutefois fait prononcer le plus souvent le nom d’un élève de Raphaël, Giovanni Francesco Penni, et retarder son exécution aux alentours de 1518. |
|
|
Saint Michel terrassant le démon, dit Le Grand Saint Michel (1518), de Raphaël. Commandé en 1518 par le pape Léon X à l'intention de François Ier, à qui il fut offert quelques mois plus tard par le neveu du pape, Lorenzo de' Medici, dans le cadre des échanges diplomatiques qui scellaient l'alliance récente du roi de France avec la papauté. Le thème de l'archange saint Michel terrassant le démon est une flatterie à l'égard de l'Ordre de Saint Michel, dont le roi était grand-maître et dont l'existence même était le gage de l'union de la France et de l'Église, renouvelée à cette date pour lutter contre les Turcs. |
Portrait de jeune homme (1524), de Parmigianno. Traditionnellement attribué à Raphaël au XVIIe siècle, le tableau a été rapproché du célèbre autoportrait au miroir convexe peint par Parmigianino en 1524 avant son départ pour Rome (Vienne, Kunsthistorisches Museum), mais on a aussi proposé récemment d'y voir une oeuvre de Corrège. |
|
Le Mariage mystique de sainte Catherine, devant saint Sébastien (1527), du Corrège. Peint pour un ami du peintre, le docteur Francesco Grillenzoni de Modène, sans doute aux alentours de 1526 - 1527 ; resté à Modène tout au long du XVIe siècle, avant de devenir au XVIIe siècle un des joyaux de la collection du cardinal Barberini à Rome puis du cardinal Mazarin à Paris.

|
Le printemps (1573), de Giuseppe Arcimboldo. Ce tableau représente un adolescent dont le visage est fait de fleurs fraîches et de feuilles dont les couleurs dominantes sont le vert, le jaune et le rouge. Cette "tête composée" est l'une des cinq peintures réalisées par Arcimboldo sur le thème des quatre saisons en utilisant des objets et des végétaux correspondant à chaque saison. |
|
L'Eté (1573), de Giuseppe Arcimboldo. Les Saisons est une série de quatre tableaux peints par Giuseppe Arcimboldo en 1563, en 1569 et en 1572 et en 1573. Chaque tableau est constitué d’un portrait de profil, composé d’éléments rappelant la saison. Signé et daté sur le col et la manche : Giuseppe Arcimboldo. |
La Diseuse de bonne aventure (1571), du Caravage. Un jeune homme élégant se fait prédire son avenir par une bohémienne qui lui dérobe discrètement l'anneau passé à sa main droite. Une autre version de ce sujet est conservée à Rome, Musei Capitolini.

Renaud et Armide (1621), du Dominiquin. Peint pour Ferdinando Gonzaga, duc de Mantoue. Le sujet est tiré de La Jérusalem délivrée (1581) du Tasse (Torquato Tasso) et la composition s'inspire de celle d'un tableau de même sujet peint vers 1601-1602 par Annibal Carrache (Naples, Museo di Capodimonte).


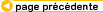

|







