Etape 34 - Musée du Louvre - Les peintures françaises
Mercredi 28 décembre 2016. Retour au Louvre*** pour une poursuite de la visite de ses collections. Cet après-midi, je me consacrerait seulement aux peintures françaises et italiennes. Pour commencer, impossible de ne pas mentionner un des tableaux les plus connus des Français : La Liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix, qui a pour cadre les trois journées du soulèvement populaire parisien contre Charles X, les 27, 28 et 29 juillet 1830, connues sous le nom des Trois Glorieuses.

Sans oublier bien entendu l'incontournable Radeau de la Méduse, de Théodore Géricault, qui représente un épisode tragique de l'histoire de la marine coloniale française : le naufrage de la frégate Méduse. Celle-ci était chargée d'acheminer le matériel administratif, les fonctionnaires et les militaires affectés à ce qui deviendra la colonie du Sénégal. Elle s'est échouée le 2 juillet 1816 sur un banc de sable. Au moins 147 personnes se maintiennent à la surface de l'eau sur un radeau de fortune et seuls quinze embarquent le 17 juillet à bord de L’Argus, un bateau venu les secourir.

Autre oeuvre magistrale, Madame Récamier, du peintre David (1800). Juliette Récamier, épouse d'un banquier parisien, fut l'une des femmes les plus en vue de son temps. Ce portrait, qui la présente vêtue "à l'antique", dans un cadre dépouillé, entourée de meubles pompéiens est en 1800 à l'avant-garde de la mode. Son inachèvement - dont la raison est mal définie - permet d'étudier la technique de David, avant que les touches vibrantes et les "frottis" du fond ne soient "glacés" de couleurs translucides.

Autre oeuvre magistrale de David : Le Sacre de Napoléon (1807). Dans ce tableau commandé par Napoléon 1er, David met en scène le caractère fastueux du Sacre et son message politique et symbolique. Témoin oculaire de la cérémonie, il en rendra avec réalisme la foule chamarrée mais il devra aussi répondre aux intentions de l’Empereur. Une fois en atelier, il devra concilier valeur documentaire et solutions artistiques. Il relève ainsi le défi de réaliser un ouvrage monumental à la gloire de l’événement et de l’inscrire, comme une œuvre à part, dans l’histoire de la peinture.

Le peintre distingue les personnages essentiels en les plaçant au centre et en les éclairant d’un faisceau de lumière. Ainsi l’arcade forme autour du couple impérial un cadre solennel et la foule les entoure, tel un écrin scintillant. A droite se trouve le Pape entouré des cardinaux et des évêques. Au premier plan, vus de dos et de trois-quarts, les grands dignitaires de l’Empire portent les signes du pouvoir impérial dont le sceptre surmonté de l’Aigle, la main de Justice et le Globe. Les deux frères et les deux sœurs de l’Empereur se trouvent à gauche. A l’arrière plan, du haut de la tribune officielle, la mère de Napoléon domine la scène. Tous les regards convergent vers la couronne.

|
Jean-Baptiste Isabey avec sa fille, 1795, François Gérard. Ami de François Gérard, le peintre Isabey était connu par ses miniatures, très prisées dans toute l’Europe.
Antoine-Jean Gros (1771-1835) entre dans l’atelier de David en 1785. Grâce à son maître, il voyage en Italie où il étudie les coloristes du XVIe siècle. Introduit auprès de Joséphine et de Bonaparte, il exécute le portrait de ce dernier « Bonaparte au pont d’Arcole ». Dans la première décennie du XIXe siècle, il exécute ses œuvres les plus importantes : « Les Pestiférés de Jaffa » et « Le Champ de bataille d’Eylau ».
|
Incontournable encore : L’Enlèvement des Sabines, 1799, Jacques Louis David. Le nu et l’élégance des silhouettes s’expliquent par la volonté du peintre de revenir à une Antiquité plus haute, plus épurée, « grecque ». Pour la première fois dans un tableau d’histoire de David le personnage central est une femme, Hersilie qui s’interpose entre Romulus, son mari, à droite, et le roi des Sabins, Tatius, son père, sur la gauche. D’autres femmes s’accrochent aux guerriers et placent leurs enfants entre les groupes opposés. L’image des conflits familiaux des Sabins était une métaphore du processus révolutionnaire qui aboutit à la paix et à la réconciliation. Le tableau fut présenté en 1799, dans une exposition privée à l’entrée payante.

Scène de déluge, de Girodet (1806). Le tableau, aboutissement d’un projet qui prit naissance en Italie, obtint un tel succès au Salon de 1806 que les noms de Milton, Dante et Michel-Ange furent associés au sien. Le sujet, une famille prise dans une catastrophe naturelle, fait divers digne d’une scène de genre, fut traité par le peintre dans un très grand format réservé à la peinture d’histoire. |
|
|
Scènes des massacres de Scio : familles grecques attendant la mort ou l'esclavage, d'Eugène Delacroix. Ce tableau représente les massacres perpétrés à Chios en avril 1822 par les Ottomans lors de la guerre d'indépendance grecque. Ici, les Grecs suscitent la pitié : pas de héros grecs se défendant vaillamment contre les troupes ottomanes, seulement quelques rares habitants désarmés qui ne sont pas en état de résister à l'envahisseur. De la même manière, le cavalier ottoman à la droite du tableau surplombe toute la scène et adopte une posture héroïque. |
Enfin, et même si ce tableau appartient à la collection espagnole du Louvre, comment ne pas citer Saint Louis, roi de France et un page (1597), par Le Greco. Il représente le roi de France saint Louis couronné, en armure à mi-cuisse, tenant le sceptre à fleur de lys et la main de justice. À son côté gauche, un jeune page vêtu d'un pourpoint et d'une chemise au col et manches à fraise porte son casque. Ils sont vêtus à la mode de la fin du xvie siècle avec une influence vénitienne. |
|
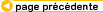

|

